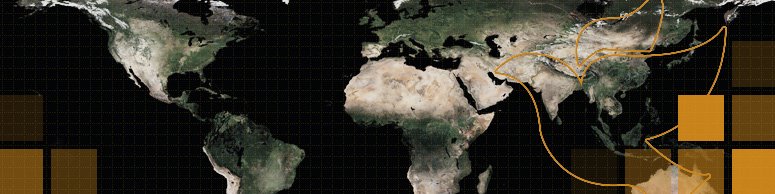Un retour au jeu :
Les contributions potentielles du Canada aux opérations de paix des Nations Unies
Soumission déposée par M. W. Dorn (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), Toronto, 17 Septembre 2016 (English version)
Le premier ministre a déclaré que « le Canada est de retour » sur l'échiquier mondial. Il a chargé ses ministres de la Défense nationale et des Affaires étrangères de se réengager dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Que peut-on faire? Beaucoup de choses! Voici une liste d'idées (et des détails).
– Placer plusieurs officiers au Bureau des affaires militaires (BAM) du Département des opérations de maintien de la paix (DOMP) à New York afin d'aider les Nations Unies et de se faire les « yeux et les oreilles » du Canada, une présence précieuse, au sein de l'organisation mondiale. Un général canadien (Maurice Baril) a déjà dirigé le BAM; cependant, le Canada ne fait pas partie actuellement des 70 pays que regroupe le BAM. Le Canada pourrait fournir les services de plusieurs officiers clés pour aider à la collecte du renseignement et l’analyse sur les opérations, notamment.
– Placer des Canadiens (militaires, policiers et civils) dans les opérations en campagne, comme personnes et dans des unités formées. À l'heure actuelle, moins de 30 militaires canadiens participent à des opérations de déploiement des Nations Unies. Il s'agit de la contribution la plus basse du Canada, au moment où les forces des Nations Unies atteignent un nombre record (92 000). Le Canada se classe au 67e rang, et les forces policières canadiennes fournissent davantage de personnel que les militaires. Les Forces armées canadiennes (FAC) pourraient facilement multiplier par dix le nombre de militaires participant à de telles opérations pour atteindre le niveau de 2005 (près de 300). Dans les situations urgentes, le Canada pourrait encore multiplier ce nombre par dix pour atteindre le niveau de 1993 (3 300 militaires participant à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies).
– Envoyer le personnel militaire féminin. Les Nations Unies mettent l'accent sur ca. Le Canada devance de nombreux pays pour ce qui est de l'embauche de femmes soldats, même si leur nombre est bien inférieur à l'objectif de 25 % que s'est fixé le MDN. Le Canada peut offrir du personnel militaire féminin qualifié pour occuper des postes au siège des Nations unies et dans les opérations en campagne, y compris des postes de chef militaire. Les Nations Unies ont nommé la première femme commandante (de la Norvège) de la force des Nations Unies en 2013.
– Offrir les services de chefs militaires, p. ex. un commandant de la force canadien, pour diriger la composante militaire d'une mission des Nations Unies. Le Canada a fourni cinq chefs militaires dans les années 1990, mais aucun depuis; il en va de même pour le chef de mission ou le représentant spécial du secrétaire général (RSSG). Des Canadiens ont occupé une ou deux fois seulement le poste de RSSG au cours de la dernière décennie. Le Canada devrait faire pression pour que des candidats très qualifiés servent à titre de chefs de mission et d'éléments militaires.
– Dresser une liste spéciale du personnel civil et militaire d’Affaires mondiales Canada (AMC) et du MDN qui souhaite participer à une mission des Nations Unies, comme le fait la GRC. Créer un grand nombre de postes permanents pour les missions des Nations Unies, comme le Canada le fait pour l'OTAN.
– Appuyer les missions de prévention des Nations Unies, y compris les déploiements préventifs de forces dans les zones de conflit potentiel. Les Nations Unies ont conduit avec succès une telle mission en Macédoine (FORDEPRENU) et pourraient le refaire dans de nombreux cas.
– Réintégrer des forces de réserve, comme la Brigade multinationale d’intervention rapide des forces en attente des Nations Unies (BIRFA, 1996-2009), dont la fin a été causée surtout par l'obsession de l'Afghanistan chez les militaires occidentaux. Mais le besoin de forces de réserve demeure toujours aussi grand, surtout au moment où des pays occidentaux, comme la Suède et les Pays-Bas le font au Mali, se réengagent au maintien de la paix.
– Appuyer la constitution d'une unité permanente de maintien de la paix en vue d'un déploiement rapide. (Voir le concept de service d’urgence pour la paix des Nations Unies, ou SUPNU, de Peter Langille.)
– Ranimer la proposition canadienne concernant l'établissement d'un quartier général militaire déployable rapidement (QGMDR). Le Canada, qui a occupé la présidence de l'organisme gouvernemental Friends of Rapid Deployment (Amis des déploiements rapides), pourrait rétablir un tel organisme à l'avenir. Les Nations Unies procèdent à la mise en place d'un nouveau mécanisme de mise sur pied stratégique d’une force. C'est le bon moment pour le Canada de s'engager auprès de l'organisation pendant la mise au point du nouveau mécanisme.
– Accroître l'instruction donnée en vue des opérations de paix. (Le contexte et les propositions détaillés sont présentés dans mon rapport de février 2016). Créer un centre international des opérations de paix canadien destiné à la formation/éducation interarmées des militaires, policiers et civils canadiens et étrangers. Le Centre Pearson pour le maintien de la paix (CPM) est un bon modèle sur lequel s'appuyer (le CPM a fermé en 2013 en raison d'un manque de financement et de soutien). Le Centre de formation pour le soutien de la paix (ou CFSP, situé à la Base des Forces canadiennes Kingston) peut élargir son offre de cours. Cependant, ce n'est pas un bon endroit où héberger le nouveau centre, car il est trop axé sur les activités tactiques et militaires. Le nouveau centre pourrait être situé tout près, pendant qu’on travaillerait à l'établissement d'un « partenariat » civil-militaire efficace, un volet fondamental des opérations de paix qui vise l'avancement des processus de paix d'ordre politique ou diplomatique. On pourrait aussi établir des partenariats avec l'International Association of Peacekeeping Training Centres (IAPTC, une association fondée au CPM en 1995).
– Développer une capacité de déploiement civile. La collaboration civile, militaire et policière et son intégration sont au cœur des opérations de paix. Comme le Canada l'a appris en Afghanistan, le personnel civil est essentiel aux missions, mais il est difficile de trouver des civils bien entraînés qui peuvent être déployés. Le gouvernement Martin caressait l'idée de constituer un « corps canadien » afin de promouvoir la saine gouvernance et le renforcement des institutions dans les régions instables. Il est possible d'étudier de telles idées sous tous leurs aspects (et même des noms) encore une fois, et le centre des opérations de paix y jouerait un rôle clé.
Sur le plan des activités et du matériel particuliers, par opposition au personnel et aux institutions, j'ai aussi quelques suggestions à offrir : assurer une partie du transport tactique et stratégique en utilisant les hélicoptères du Canada (Griffon et Chinook) et des aéronefs de transport lourd (C17) ainsi que les aéronefs Hercules habituels. Offrir des capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (RSR) de pointe, en particulier un escadron équipé du véhicule de reconnaissance Coyote qui s'est révélé si efficace au cours de la mission Éthiopie-Érythrée. Contribuer à l'innovation technologique dans les opérations de paix de l'ONU par le biais du partenariat pour la technologie dans le maintien de la paix des Nations Unies et en fournissant les services de spécialistes. Fournir des éléments habilitants spécialisés, comme des unités du génie ainsi que des transmissions/communications, des domaines où le Canada excelle traditionnellement qui ont été bien utilisés au cours d'opérations antérieures. En matière de soutien de mission, le Canada pourrait offrir des unités médicales et, dans une situation d'urgence, du personnel et des unités de secours humanitaire, dont l'Équipe d’intervention en cas de catastrophe (EIC). Aider les Nations Unies à développer la doctrine, les instructions permanentes d’opérations (IPO) et les modules de formation en intégrant des études de cas concernant les principaux secteurs, comme la technologie de soutien et de surveillance des cessez-le-feu (bien nécessaires dans des pays comme la Syrie, le Yémen et la Libye), etc. Démontrer aux Nations Unies comment la protection des civils peut être assurée par l'exemple et en présentant des études de cas de mesures prises par le passé par les Nations Unies, le Canada et d'autre pays.
Le Canada a tant de capacités à offrir aux opérations de paix des Nations Unies, à leur siège et en campagne. Le Canada possède des forces réelles qui lui procurent un avantage concurrentiel en situation de déploiement : une mosaïque multiculturelle, une fonction publique bilingue, la protection des droits des groupes minoritaires, la primauté du droit et un service de longue date (réduit toutefois au cours de la dernière décennie) aux causes des Nations Unies. C'est un pays qui n'a pas le passé colonialiste que portent encore les grandes puissances dans de nombreuses régions déchirées par les conflits. Le Canada a un appareil militaire moderne qui peut fournir d'excellents soldats du maintien de la paix ayant reçu un nouvel entraînement et du recyclage. Il peut venir en aide, en particulier, aux pays francophones comme Haïti, le Mali, RDC et la République centrafricaine.
Il y a beaucoup de choses à faire pour s'engager (de nouveau) dans des opérations de paix. Le modus operandi que je propose consiste à « appuyer ce qui avance », c'est-à-dire d'entreprendre rapidement un large éventail d'initiatives, de distinguer celles qui avancent et de les transformer en projets de premier plan afin de montrer que le Canada est vraiment, sur l'échiquier mondial, une force constructive qui contribue à ramener la paix dans les régions du monde déchirées par la guerre. C'est alors seulement que nous pourrons aider à cicatriser les plaies ouvertes dans le monde entier qui entraînent une hémorragie de problèmes sur le reste de la planète. C'est alors seulement que les flots de réfugiés pourront être endigués, les maladies éradiquées et le terrorisme extirpé à sa source. C'est alors seulement que le Canada pourra vraiment dire qu'il est de retour.